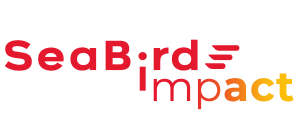Renforcer l’assurance des forêts et des autres écosystèmes

Article extrait de notre étude : « Assurance & post-croissance : comment protéger à l’aune des limites planétaires ? »
La forêt française, comme de nombreux autres écosystèmes, apparaît particulièrement menacée par le changement climatique et la dégradation de la biodiversité. L’assurance forêt peut soutenir le renouvellement des essences et l’adaptation des forêts tout en offrant une stabilité aux revenus de la filière bois. Mais pour atteindre la taille critique nécessaire, plusieurs obstacles devront être surmontés, qui impliquent une coopération plus approfondie des assureurs avec l’ensemble des acteurs de la filière. L’assurance forêt constitue ainsi un laboratoire des actions qui peuvent être menées par les assureurs pour préserver et restaurer les écosystèmes en tant qu’ils contribuent à une réduction des risques qui pèsent sur l’ensemble de la société.
L’assurance forêt est historiquement limitée en France, alors même que les forêts sont menacées par le réchauffement climatique
Des forêts françaises insuffisamment gérées et peu assurées
75 % des 17 millions d’hectares de forêts françaises sont privées, parmi lesquelles « la moitié est constituée de parcelles de plus de 25 hectares, dotées au moins d’un plan simple de gestion, et qui hébergent parfois une activité économique. L’autre moitié n’est que peu ou pas gérée car de petite dimension – souvent moins de 15 hectares – et issue de petites parcelles attenantes à d’anciennes exploitations agricoles », nous rappelle Hervé Le Bouler, forestier conseiller du domaine de Chantilly et du projet AXA Forest for good, rencontré dans le cadre de cette étude.
Le morcellement des propriétés forestières a conduit à un oubli progressif de certaines parcelles. La forêt s’étend par ailleurs sur des parcelles en friche, libérées par la déprise agricole « assimilées à de la brousse, un phénomène totalement nouveau. Une partie de la forêt française est en libre évolution ». Dans les faits, seuls 18% de la forêt privée disposent d’un plan simple de gestion (Institut Géographique National, 2023a) : obligatoire pour toute propriété forestière de plus de 20 hectares*, une si faible couverture montre bien la prédominance des petites propriétés, parfois non gérées.
Le faible entretien des parcelles forestières accroît les risques auxquels elles sont soumises. En 2022, un rapport d’information du Sénat notait l’importance du mode de gestion dans la prévention des risques : « peu rentable économiquement, caractérisée par un morcellement de la propriété et une absence de gestion, y compris pour de plus grandes surfaces, la forêt méditerranéenne est principalement protégée par les actions de prévision** et de lutte portées par la puissance publique […] faute d’investissements et d’actions de prévention suffisantes de la part des propriétaires privés » (Bacci et al., 2022).
Or, l’assurance forêt est historiquement peu développée – selon Guillaume Bouffard, Directeur général de Groupama Forêts Assurance, interrogé dans le cadre de cette étude, la forêt privée n’est assurée qu’à hauteur de 10 % environ contre les incendies et/ou tempêtes – et cantonnée à certaines zones – plus de 20% de la forêt des Landes est par exemple assurée en dommages.
Par ailleurs, si l’État est son propre assureur pour les forêts domaniales, les collectivités locales pourraient, en théorie, souscrire une assurance pour les 2,7 millions d’hectares de forêt communale. Guillaume Bouffard rappelle cependant que cette pratique est encore peu répandue, et la couverture assurantielle des forêts publiques reste très limitée. Les assureurs manquent d’historique sur certains territoires où la culture assurantielle est moins prégnante, et d’une masse assurable suffisante pour permettre une meilleure mutualisation. Pour les forêts qui n’hébergent pas d’activités économiques, la survenance d’un aléa n’engendre pas de conséquence financière (en dehors de la responsabilité civile) : les propriétaires ont donc moins d’intérêt à s’assurer s’ils ne tirent pas de revenu de leur forêt.
L’assurance est donc souvent limitée à la responsabilité civile, et inclut parfois les risques tempête et incendie dans le cas d’exploitations forestières dont les revenus dépendent de la production de bois. Les menaces phytosanitaires (maladies et parasites, tous deux fortement accélérés par le changement climatique) et les dégâts de gibier sont systématiquement exclus. Quant aux indemnisations, elles couvrent, dans 90 % des cas, uniquement les coûts de replantation, et non les pertes en capital*** : elles ne correspondent pas à la valeur de l’arbre sur pied.
*Ce seuil était de 25 hectares jusqu’en 2023 ; il a été abaissé à 20 hectares par la loi du 10 juillet 2023 relative à la prévention et à la lutte contre le risque incendie qui a modifié l’article L312-1 du Code Forestier.
**Au sens de prévision des départs de feu, et de dimensionnement des besoins en termes de moyens de lutte contre les incendies.
***D’après Guillaume Bouffard, directeur général de Groupama Misso, rencontré dans le cadre de cette étude.
Les forêts sont de plus en plus menacées par le changement climatique
Le taux de mortalité des arbres dans les forêts françaises a augmenté de 80 % en l’espace de 10 ans (IGN, 2023a) – 5 % de la forêt française est actuellement dépérissante (IGN, 2023a). La faible part des forêts gérées et assurées interroge alors sur la capacité des forêts à faire face aux bouleversements climatiques.
Les forêts de l’Hexagone subissent des stress hydriques de plus en plus fréquents, conjugués à des attaques de parasites et des incendies de plus en plus violents, ainsi qu’à une hausse des populations d’ongulés sauvages (Fransylva & CNPF, 2021, p. 35). Conditions climatiques et faible biodiversité rendent les forêts plus vulnérables aux attaques : des cultures spécialisées historiques telles que les épicéas des Vosges se révèlent particulièrement vulnérables aux parasites (le scolyte notamment). Ces phénomènes ont déjà des conséquences pour les forêts qui présentent un déficit foliaire croissant, amenant l’IGN à observer une « nette dégradation de l’état de santé des arbres » (IGN, 2020, p. 12), en rappelant que les peuplements dépérissants couvrent une surface équivalente à la surface « incendiée au cours des trente-cinq dernières années » (IGN, 2023a).
Au-delà de l’atteinte à la valeur des produits forestiers, cette dégradation pénalise les services rendus par les forêts, notamment leur rôle de puits de carbone : « bien que le stock de carbone continue d’augmenter, les résultats de l’Inventaire Forestier National montrent depuis quelques années un ralentissement notable de la dynamique du puits de carbone, entraîné par la multiplication des crises sanitaires combinée à des épisodes de forte sécheresse et de canicule. Ainsi, le puits [a diminué] d’un tiers en une décennie. » (IGN, 2023b).
Les assureurs manquent d’historique sur certains territoires où la culture assurantielle est moins prégnante, et d’une masse assurable suffisante pour permettre une meilleure mutualisation.
Hervé Le Bouler évoque une brusque modification des perspectives : « On commence à observer dans des forêts en souffrance un ralentissement de la croissance nette des arbres : il n’est pas impossible que d’ici 4 ou 5 ans, la forêt hexagonale rejette plus de carbone qu’elle n’en absorbe. »
À cela s’ajoute l’urgence de mobiliser des moyens pour adapter les forêts au changement climatique. La plupart des forêts auront, en effet, besoin d’une intervention humaine face à des conditions climatiques qui évoluent trop rapidement. L’introduction d’essences plus résilientes au changement climatique a déjà lieu : « dans le domaine de Chantilly, au lieu de planter une seule espèce, on en combine trois. Sur trois quarts de la surface nous plantons un tiers de feuillus, un tiers d’un résineux à croissance rapide et un tiers de résineux à croissance plus lente. Et en surplus on conserve un quart où on laisse faire la nature ».
Une intervention qui apparaît nécessaire alors que le changement rapide des conditions climatiques impose une contrainte que la mobilité naturelle des écosystèmes ne peut pas suivre : « un peuplement se déplace de 100 mètres par an ; il y a donc quelques siècles d’attente avant que les peuplements actuels atteignent les zones qui leur seront favorables dans le climat futur. […] On plante déjà 20 millions d’arbres par an ; l’année dernière 40 % des arbres que nous avons plantés sont morts. Avec cette mortalité, et parce qu’on manque des graines nécessaires et du personnel, on ne peut pas remplacer ce qu’il y avait avant ».
Enfin, l’histoire récente souligne l’efficacité de la prévention et de la lutte face à certains des risques auxquels les forêts sont soumises, notamment le risque incendie – 90 % des départs de feu sont d’origine humaine. Les efforts déployés dans les années 1990 ont prouvé leur efficacité, faisant chuter les surfaces brulées, de près de 40 000 hectares par an sur la période 1979-1988 à environ 15 000 hectares par an entre 2013 et 2022 (Base de données sur les incendies de forêt en France, 2023). La prévention des incendies s’est notamment améliorée dans le sud-est (Bacci et al., 2022, p. 25), permettant de réduire les surfaces brûlées malgré des conditions de plus en plus sèches. Dans une moindre mesure, les risques phytosanitaires peuvent aussi être prévenus par une gestion minutieuse des parcelles.
Le risque tempête pose quant à lui un problème de taille au secteur forestier, tant par la difficulté à le prévenir que par ses conséquences : les tempêtes provoquent une offre abondante de bois et appliquent une pression à la baisse sur les cours. En cela, elles menacent la stabilité financière du secteur forestier et sa capacité à replanter les zones déboisées. Mais elles soulignent lui aussi la nécessité d’une gestion anticipatrice pour rebondir rapidement après les sinistres.
Il est donc urgent de mobiliser des moyens pour accompagner les forêts dans leur mutation : les forêts françaises devront s’adapter à un rythme sans précédent face à l’évolution rapide des conditions climatiques locales. Dans ce contexte, l’assurance apparaît plus que jamais pertinente, car elle contribue à mutualiser des financements pour les diriger vers les forêts qui ont subi des dégâts – et qui disposent donc d’espaces libres pour la replantation avec des essences diversifiées et adaptées aux conditions climatiques futures.
Développer l’assurance forêt : des leviers publics et privés pour accroître la résilience et soutenir le renouvellement des forêts
Atteindre une surface assurée critique pour surmonter ces obstacles
La faible part des forêts françaises assurée n’est pas une fatalité au vu des fortes disparités entre les pays : 55 % de la surface forestière néo-zélandaise est assurée, 50% en Chine ou 60 % au Chili (Zhang & Stenger, 2014).
Tout indique que la situation actuelle pourrait évoluer avec l’atteinte d’un seuil critique au-delà duquel une forme d’équilibre dans la mutualisation pourrait être trouvé. Une étude en Allemagne indiquait ainsi que le montant de la prime d’assurance à l’hectare pour le risque tempête pouvait être divisé par 10 quand la superficie était multipliée par 100, de 1 400 à 140 000 hectares (Holecy & Hanewinkel, 2016). Atteindre ce seuil critique de mutualisation reposera sur un progrès des niveaux de mutualisation tant sur la forêt privée que pour les forêts communales.
« D’un côté il y a une crise de rentabilité, de l’autre, une pression exercée sur les assurés de pouvoir maintenir la capacité financière de payer les primes »
Guillaume Bouffard, Groupama Forêt
Or, l’atteinte de ce seuil critique et d’une couverture plus large est une priorité : les primes d’assurance associées au risque incendie se renchériront rapidement avec l’augmentation des feux… Ainsi témoigne Guillaume Bouffard : « un renchérissement de l’assurance pour les risques climatiques est inévitable. On prévoit des évènements plus fréquents et plus coûteux. Dans le cas spécifique du risque incendie, l’assèchement des terres qui se propage sur tout le territoire, y compris aux zones historiquement moins exposées vers le nord provoquera inéluctablement un renchérissement tarifaire pour les forêts. Nous devrons continuer nos efforts déployés pour développer les surfaces assurées et nos couvertures, et ainsi répondre au dilemme actuel auquel font face les assureurs du risque forêt face au changement climatique : d’un côté il y a une crise de rentabilité avec le renchérissement de coûts liés à la sinistralité grandissante, supérieure aux primes et, de l’autre, une pression exercée sur les assurés de pouvoir maintenir la capacité financière de payer le prix de la protection (les primes). Le développement des surfaces assurées et l’amélioration des couvertures offertes sont des facteurs clés pour éviter la non-assurabilité et continuer de protéger les forêts et leur rôle crucial dans nos écosystèmes ».
Une politique volontariste des pouvoirs publics, nécessaire mais pas suffisante
Un soutien étatique temporaire pourrait aider le marché de l’assurance forêt à atteindre une taille critique, à l’image du réassureur FloodRe au Royaume-Uni, qui cessera d’exister une fois un marché de l’assurance inondations implanté dans le pays.
Mais il ne sera en aucun cas suffisant : de tels soutiens ont déjà été développés par le passé sans que le marché ne se développe significativement. C’est ainsi qu’avec la loi de Modernisation agricole (votée en 2010), l’État a cessé de soutenir les propriétaires forestiers assurés victimes d’une tempête. D’autant que des dispositifs fiscaux incitatifs existent toujours. Citons notamment le « dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt » (DEFI Assurance), amélioré en 2023 et prolongé jusqu’en 2027, qui rend éligible à un crédit d’impôt sur le revenu la cotisation versée au titre d’une assurance tempête ou incendie.
Le soutien des pouvoirs publics ne peut donc faire l’économie d’une démarche des assureurs pour comprendre les nouveaux besoins en assurance des forestiers et leur proposer des produits adaptés. Selon Guillaume Bouffard, pour mieux répondre aux besoins du secteur forestier tout en garantissant l’assurabilité, les assureurs réfléchissent à des mesures d’adaptation des contrats d’assurance forêt, en intégrant des systèmes de bonus/malus pour valoriser (ou pénaliser) les bonnes (ou mauvaises) pratiques en matière de prévention des risques et de gestion forestière. Mais les assureurs peuvent aussi jouer un rôle de prévention plus direct auprès de leurs assurés, en complément de, ou en partenariat avec les grandes institutions forestières comme le CNPF. Enfin, sur le modèle de l’assurance MRC pour les récoltes (cf. article consacré à ce dispositif p. 55), il pourrait être envisagé de mettre en place une répartition des risques institutionnalisée, combinant un subventionnement des primes d’assurance et une intervention de l’État comme assureur en dernier ressort en cas d’évènement extrême.
Assurer les forêts, malgré la parcellisation de la propriété
En Norvège, l’assurance contre les incendies de forêt est centralisée par l’association forestière norvégienne créée en 1912 ; elle couvrait environ 80 % des propriétaires forestiers dès 1950 (Zhang & Stenger, 2014). Cette situation, radicalement différente de la parcellisation forestière observée en France, invite les assureurs à expérimenter de nouvelles formes de contractualisation multipartites, moins dépendantes de la propriété forestière, par exemple avec les collectivités locales qui bénéficient des services rendus par ces forêts, ou avec des collectifs de citoyens. De cette façon, l’assurance forêt pourrait trouver de nouvelles opportunités de diffusion.
Face au manque de gestion de certaines parcelles – et principalement des plus petites – des services voient le jour, sur la base de techniques juridiques innovantes. Neosylva, propose par exemple un contrat juridique innovant dissociant la propriété de la parcelle à travers des contrats de 99 ans. La nue-propriété est conservée par le propriétaire, tandis que l’usufruit est confié à Neosylva, qui assure la gestion des bois et leur valorisation économique. La durée du contrat garantit une continuité dans la gestion de la forêt : ainsi gérée, la propagation des incendies est plus faible et une attention est portée à la résilience des parcelles – par des enrichissements avec des essences résilientes et respectueuses de la biodiversité.
Les assureurs peuvent faire émerger des formes de gouvernance hybrides mieux adaptées à la gestion de biens communs tels que les forêts.
Alors que l’éclatement de la propriété forestière distend le lien entre les citoyens et les forestiers, les assureurs peuvent alors encourager une réappropriation locale de la gestion des forêts par celles et ceux qui en bénéficient, sans en conserver la propriété, et ainsi diffuser les pratiques préventives. Il s’agit alors de faire émerger des formes de gouvernance hybrides mieux adaptées à la gestion de biens communs (Ostrom, 1990), pour pallier les insuffisances du marché ou d’une gestion centralisée en la matière.